Ru de Kim Thuy
Ru de Kim Thuy née en 1968
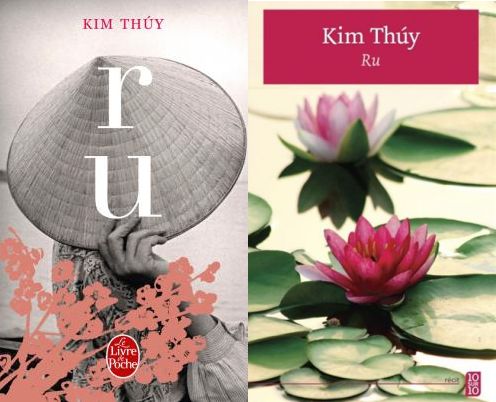
Récit publié en France chez Liana Levi en 2009, puis au Livre de poche (215 pages) Dans « Ru », sa première œuvre littéraire, Kim Thuy dévoile ses souvenirs d’ici et d’ailleurs, pêle-mêle, passant d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre. En très courts fragments, Kim Thuy nous invite à des allers-retours entre le Vietnam et le Québec.
Elle dit les origines, le lien à la mère, à ses fils au fil d’un « ru » qui porte des images du passé et du présent.
Son écriture est d’une extrême finesse. Les phrases tantôt courtes presque brutales s’allongent souvent, se colorant d’ironie ou de tendresse.
Invitation à la lecture des 4 premiers morceaux du récit autobiographique
-
Epigraphe
En français, ru signifie « petit ruisseau » et, au figuré, « écoulement (de larmes, de sang, d’argent) » (Le Robert historique). En vietnamien, ru signifie « berceuse », « bercer ».
Puis le livre est dédié Aux gens du pays.
Lequel ? Le pays de naissance ou le pays d’adoption ?
• Je suis venue au monde pendant l’offensive du Têt, aux premiers jours de la nouvelle année du Singe, lorsque les longues chaînes de pétards accrochées devant les maisons explosaient en polyphonie avec le son des mitraillettes.
J’ai vu le jour à Saigon, là où les débris des pétards éclatés en mille miettes coloraient le sol de rouge comme les pétales de cerisier, ou comme le sang des deux millions de soldats déployés, éparpillés dans les villes et les villages d’un Vietnam déchiré en deux.
Je suis née à l’ombre de ces cieux ornés de feux d’artifice, décorés de guirlandes lumineuses, traversés de roquettes et de fusées. Ma naissance a eu pour mission de remplacer les vies perdues. Ma vie avait le devoir de continuer celle de ma mère.
• Je m’appelle Nguyen An Tinh et ma mère Nguyen An Tinh. Mon nom est une simple variation du sien puisque seul un point sous le i me différencie d’elle, me distingue d’elle, me dissocie d’elle. J’étais une extension d’elle, jusque dans le sens de mon nom. En vietnamien, le sien veut dire « environnement paisible » et le mien « intérieur paisible ». Par ces noms presque interchangeables, ma mère confirmait que j’étais une suite d’elle, que je continuerais son histoire.
L’Histoire du Vietnam, celle avec un grand H, a déjoué les plans de ma mère. Elle a jeté les accents de nos noms à l’eau quand elle nous a fait traverser le golfe du Siam, il y a trente ans. Elle a aussi dépouillé nos noms de leur sens, les réduisant à des sons à la fois étrangers et étranges dans la langue française. Elle est surtout venue rompre mon rôle de prolongement naturel de ma mère quand j’ai eu dix ans.
• Grâce à l’exil, mes enfants n’ont jamais été des prolongements de mon histoire. Ils s’appellent Pascal et Henri et ne me ressemblent pas. Ils ont les cheveux clairs, la peau blanche et les cils touffus. Je n’ai pas éprouvé le sentiment naturel de la maternité auquel je m’attendais quand ils étaient accrochés à mes seins à trois heures du matin, au milieu de la nuit. L’instinct maternel m’est venu plus tard, au fil des nuits blanches, des couches souillées, des sourires gratuits, des joies soudaines.
C’est seulement à ce moment-là que j’ai saisi l’amour de cette mère assise en face de moi dans la cale de notre bateau, tenant dans ses bras un bébé dont la tête était couverte de croûtes de gale puantes. J’ai eu cette image sous les yeux pendant des jours et peut-être aussi des nuits. La petite ampoule au bout d’un fil retenu par un clou rouillé diffusait dans la cale une faible lumière, toujours la même. Au fond de ce bateau, le jour ne se distinguait plus de la nuit. La constance de cet éclairage nous protégeait de l’immensité de la mer et du ciel qui nous entouraient. Les gens assis sur le pont nous rapportaient qu’il n’y avait plus de ligne de démarcation entre le bleu du ciel et le bleu de la mer.
On ne savait donc pas si on se dirigeait vers le ciel ou si on s’enfonçait dans les profondeurs de l’eau. Le paradis et l’enfer s’étaient enlacés dans le ventre de notre bateau. Le paradis promettait un tournant dans notre vie, un nouvel avenir, une nouvelle histoire. L’enfer, lui, étalait nos peurs : peur des pirates, peur de mourir de faim, peur de s’intoxiquer avec des biscottes imbibées d’huile à moteur, peur de manquer d’eau, peur de ne plus pouvoir se remettre debout, peur de devoir uriner dans ce pot rouge qui passait d’une main à l’autre, peur que cette tête d’enfant galeuse ne soit contagieuse, peur de plus jamais fouler la terre ferme, peur de ne plus revoir le visage de ses parents assis quelque part dans la pénombre au milieu de deux cents personnes.
• Avant que notre bateau ait levé l’ancre en pleine nuit sur les rives du Rach Gia, la majorité des passagers n’avaient qu’une peur, celle des communistes, d’où leur fuite. Mais, dès qu’il a été entouré, encerclé d’un seul et uniforme horizon bleu, la peur s’est transformée en un monstre à cent visages, qui nous sciait les jambes, nous empêchait de ressentir l’engourdissement de nos muscles immobilisés. Nous étions figés dans la peur, par la peur. Nous ne fermions plus les yeux quand le pipi du petit à la tête galeuse nous arrosait. Nous ne nous pincions plus le nez devant le vomi de nos voisins. Nous étions engourdis, emprisonnés par les épaules des uns et la peur de chacun. Nous étions paralysés.
L’histoire de la petite fille qui a été engloutie par la mer après avoir perdu pied en marchant sur le bord s’est propagée dans le ventre odorant du bateau comme un gaz anesthésiant, ou euphorique, qui a transformé l’unique ampoule en étoile polaire et les biscottes imbibées d’huile à moteur en biscuits au beurre. Ce goût d’huile dans la gorge, sur la langue, dans la tête nous endormait au rythme de la berceuse chantée par ma voisine.
Bonne lecture…