Un général à la retraite de Nguyên Huy Thiêp
Un général à la retraite de Nguyên Huy Thiêp
Recueil de 4 nouvelles, de 15 à 65 pages, parues à Hanoï en 1987 et 1989, traduites par Kim Lefèvre et publiées de 1990 à 2001. Éditions de l’Aube, poche.
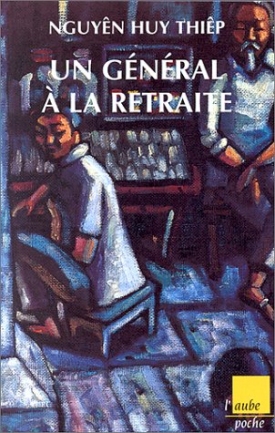
● « Un général à la retraite »
Ingénieur à l’Institut de physique, le fils du général Nguyên Thuân prend la plume pour défendre « la mémoire de son père ».
Pourtant son père est pour lui un inconnu jusqu’à son retour au village, lorsque l’heure de la retraite a sonné, à soixante-dix ans. « J’ai grandi sans rien savoir de mon père. Je suppose que ma mère ne le connaissait pas davantage. Toute sa vie était consacrée aux armes et à la guerre. »
La maison est régentée par la belle-fille du général, Thuy, médecin à la maternité. My et Vy, ses petites-filles de quatorze et douze ans ne font guère attention à lui. Sa femme a perdu la raison. M. Co et sa fille Lai simple d’esprit, recueillis par Thuy, assurent tous les travaux domestiques. Ils nourrissent et soignent les chiens et les poules que Thuy élève pour arrondir les fins de mois.
Le général cherche à se rendre utile mais on lui conseille de se reposer, d’écrire ses mémoires.
Son demi-frère Bông s’incruste dans la maison. Son neveu qui battait sa première femme, se remarie avec une institutrice qu’il a engrossée. La jeune femme est jetée dehors après une dispute entre son mari et son beau-père.
La vie suit son cours. Le général découvre que, chaque jour, sa belle-fille rapporte de la maternité les fœtus des avortements et des curetages dans une thermos, pour nourrir les animaux. Il en a « la chair de poule ».
Son épouse incontinente et grabataire meurt. On organise son enterrement. Le Nouvel An est accueilli sans « fleurs de pêche » et sans « gâteaux traditionnels ».
Peu après, le général constate que le voisin rend de fréquentes et longues visites à sa belle-fille en l’absence de son mari. Le vieil homme est sidéré d’entendre son fils lui dire de ne pas y faire attention. Il ne comprend plus rien à rien.
Aussi n’hésite-t-il pas à partir lorsque son ami, le général Chuong, lui demande de rejoindre le front à Cao Bang. Quelques jours après, le fils reçoit la nouvelle de la mort de son père. Mort pour la patrie, lors d’une mission.
Puis la vie reprend son cours, comme avant.

La phrase est sèche. Le récit court (30 pages) et alerte. Juste le temps qu’il faut au vieil homme pour se sentir dépassé par les mœurs décadentes de la société nouvelle. Lui qui a consacré sa vie aux guerres de libération du pays, qui avait comme boussole l’honneur, la dignité, l’indépendance, ne trouve autour de lui qu’indifférence, enrichissement sans état d’âme, compromissions, veulerie, violence ou fourberie.
Il ne lui reste plus qu’à mourir : suicide ou mise à mort ?
Lors de sa parution à Hanoi en 1987, au lendemain du 6ème congrès du Parti Communiste Vietnamien qui décida le « doi moi » – le « renouveau » – la nouvelle fit l’effet d’une bombe. Nguyên Huy Thiêp acquit la notoriété du jour au lendemain. Le miroir qu’il tendait à la société était brutal, sans fard.
Une scène du récit présente un caractère tragi-comique et intemporel. Lors d’une vidange de la mare, Bông et Co ont aperçu une jarre, puis deux, puis trois…ils creusent sans relâche. Tous frétillent à l’idée de trouver une fortune. Au lieu de quoi ils ramassent quelques médailles rouillées et des vieilles pièces datant de Bao Dai. « De quoi payer une barque funèbre à tous les morts de ce village, » s’esclaffe Bông.
Il est en effet traditionnel de placer neuf pièces de monnaie dans la bouche du défunt pour payer la barque funèbre. L’une des petites-filles de la grand-mère s’étonne de ce rituel. Sa jeune sœur lui répond qu’elle sait ! « Ça veut dire qu’on a toujours besoin d’argent dans la vie. Et c’est pareil quand on est mort.»
Chez les anciens Grecs, on connaît une coutume semblable : celle de placer une obole sous la langue du mort avant son enterrement afin qu’il puisse payer à Charon, le nocher des Enfers, leur passage en barque sur le Styx pour trouver la paix. Ceux qui ne pouvaient payer devaient errer sur les bords de la rivière pendant cent ans.
● « Leçons paysannes »
Hieu, dix-sept ans, fils d’un professeur et d’une mère au foyer, est invité à passer les vacances d’été chez son copain de classe, Lâm, qui vit à la campagne. C’est un évènement car Hieu n’a jamais quitté la ville.
Il est d’abord ébloui par la chaleur et la qualité du repas d’accueil, les hommes d’un côté les femmes de l’autre. Il en est encore souvent ainsi aujourd’hui, même en ville ! Le petit Tiên veut être avec les « messieurs » mais sa mère lui dit qu’il est trop petit en termes fleuris: « Tu as la quéquette pas plus grosse qu’un petit piment. Comment peux-tu être un monsieur ? » Les rires fusent. Le temps passe vite. Le père propose à Hieu de lui faire découvrir l’envol du cerf-volant. Moment magique dont le père sort en eau, épuisé avant de se précipiter vers la rivière pour se rafraîchir.

Le soir, il rejoint Sœur Hiên, vingt ans, qui pile le riz dans la remise. Elle se confie sur « l’ennui de la campagne » mais les dangers de la ville. Lors d’un court séjour à Hanoi, elle s’est laissé prendre aux beaux discours d’un dragueur. Elle s’emporte contre le sort des femmes d’être mariée trop tôt, les maris partis à l’armée ou les maris violents ou paresseux. D’où tire-t-elle ses idées se demande Hieu. Du professeur Triêu qui donne des cours de littérature pour adultes, le soir. « Il dit que la femme n’a pas besoin de grands sentiments, elle a besoin de compréhension, de caresses, et d’espèces sonnantes et trébuchantes. C’est ça, l’amour. Les grands sentiments sont réservés aux hommes politiques car la politique sans idéal c’est le désastre. » Les confidences de Hiên, son odeur, ses seins qui le frôlent suscitent de vifs émois chez Hiêu.
Le lendemain, la grand-mère de quatre-vingts ans lui confie son désir de mourir. Elle déteste la vieillesse et l’idée d’être un boulet pour ses enfants. « Quand on a des biens, il faut savoir les dépenser. A trop les accumuler, ils deviennent maléfiques…»
La visite du professeur Triêu est un nouveau motif de surprise. D’abord il est jeune, la trentaine. Ensuite il tient un discours surprenant. « Un conseil, jeune homme : ne te fourvoie pas plus tard dans les sentiers de la littérature et du savoir. Tu seras roué de coups. On te couvrira d’insultes. Tu ne seras jamais de taille à lutter contre la bêtise des gens qui détiennent des diplômes. »
L’orage gronde, la pluie se met à tomber, tous se précipitent vers la rivière avec filet et épuisette pour attraper les poissons qui « s’ébattent en nombre incalculable. » La mère de Lâm se dépêche d’aller vendre les poissons au marché. La plus jeune sœur nettoie les poissons destinés au repas. Lâm se dirige vers la digue où lit le professeur Triêu. S’engage une conversation sur les choses de la vie : la femme du voisin qu’on trouve plus désirable que la sienne, les citadins qui méprisent les paysans, la voracité des fourmis qu’il compare à celle du peuple dénué d’idéal.
Mais son père rappelle Hieu au plus vite à la ville, fâché que son épouse ait pris la liberté de l’envoyer à la campagne en son absence. « Il n’y a de pire calamité que l’acoquinement de l’intellectuel et du paysan. Crois-moi mon fils. »

Hieu, le narrateur, évoque ces quelques jours comme un espace-temps aux larges dimensions. Hieu, le personnage, reçoit dans ce village des chocs successifs – affectif, sociologique, philosophique – qui changent sa vision des hommes et de la vie. La générosité, la franchise des personnages qu’il rencontre le déconcertent et le font réfléchir. Les derniers propos du professeur qui revendique pour le peuple « le droit de décider de son propre destin, en un mot, de sa liberté » lui tirent des larmes d’émotion. L’adolescent doit quitter le village à contrecœur, pour retrouver la bassesse des « coquins ».
On perçoit dans cette courte nouvelle de 35 pages le pessimisme et le parti-pris de l’auteur qui tend à noircir le citadin et idéaliser le paysan. Pourtant ce récit d’apprentissage peut se lire comme un message de réconciliation possible entre la ville et la campagne.
● « La dernière goutte de sang »
Nguyên Huy Thiêp retrace les hauts et les bas de la famille Pham, originaire du village de Ke Noi, à partir du milieu du 19ème siècle.
Première et deuxième générations : les bouchers
Pham Ngoc Lien, boucher de profession, veut un lettré dans la famille mais il meurt sans que ce vœu soit exaucé. Bien des années après, son fils Gia, boucher lui aussi, s’aperçoit que Chieu, son petit-fils est un garçon intelligent. Il l’envoie chez un professeur renommé et Chieu réussit au concours de mandarins de Nam Dinh. Le grand-père meurt avant que les résultats ne soient connus.

Troisième génération : un sous-préfet déchu
Après la période de deuil, Chieu prend le poste de sous-préfet d’une grande juridiction. Il se souvient des propos de son maître : « La fonction mandarinale est uniquement une manière de gagner son pain. Celui qui ne sait pas en profiter est un sot. »
Il devient un sous-préfet cruel infligeant la torture, un débauché contaminé par la syphilis. Il fait fouetter un missionnaire français. Décision malheureuse qui brise sa carrière. Le voilà de retour à Ke Noi, sans emploi et sans héritier mâle, malgré les deux épouses dont il s’est doté. Par ruse, il réussit à prendre une troisième épouse qui lui donne un fils, Ngoc Phong.
Quatrième génération : un escroc !
Orphelin à seize ans, Ngoc Phong suit des études à Hanoi en vietnamien latinisé et non en caractères chinois comme son père. Un jour, il revient avec Lan, enceinte, qui prend les rênes de la maison tandis qu’il retourne à Hanoi pour se livrer à divers trafics. Lan donne naissance à une fille, Huê.
Ngoc Phong s’est associé avec Tan Dan, l’oncle de Lan, et tous deux se livrent à un trafic de sel avec un prêtre catholique de Phat Diem. Les choses tournent mal. A sa sortie de prison, Tan Dan incendie la maison de Ngoc Phong à Hanoi qui en sort brûlé mais vivant tandis que sa deuxième épouse meurt.
A Ke Noi, Lan (la première épouse) s’affiche avec son amant, un boucher. Ngoc Phong la fait tuer et se retire à la campagne où vivent ses deux fils de dix et deux ans avec leur mère Chiem, la troisième épouse.
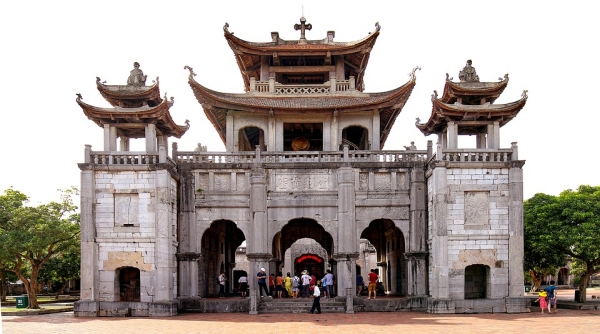
Cinquième génération : enfin un lettré ?
Ngoc Phong envoie son fils aîné Phuc à Hanoi pour y étudier mais un orage foudroie l’enfant. Le père est effondré, il ne mange plus rien et meurt, « à l’heure du cheval, le treizième jour du treizième mois de l’année du dragon (1940).
Ses derniers mots expriment son ultime espoir : « Ma chère femme, ce petit, c’est la dernière goutte de sang des Pham. J’espère qu’il coule dans ses veines un sang vermeil et non pas le sang noir de ses ancêtres. »
Epilogue
« Chiem ne s’est pas remariée afin d’élever son fils. A eux deux, ils cultivaient quelques légumes, élevaient des cochons ou confectionnaient du pâté de soja qu’ils allaient vendre au marché. Tâm était autodidacte. Il lisait beaucoup mais ne se présentait à aucun concours ni ne sollicitait aucun emploi. »

On est frappé de la tonalité finale qui évoque la petite métairie de Candide à la fin du conte de Voltaire. On croit y entendre la devise de Candide : « Il faut cultiver son jardin ».
Le héros de Voltaire atteint à cette sagesse après avoir embrassé l’optimisme de son maître, parcouru le monde à la recherche de l’amour et de la richesse, et compris que le bonheur est dans l’action collective.
Le personnage de Tâm est simplement esquissé dans la longue nouvelle (65 p.) deNguyên Huy Thiêp mais on a le sentiment que les errements, la volonté de puissance, les crimes de ses ascendants lui ont servi d’expérience et l’ont vacciné contre la fausse gloire et autres fausses valeurs. Il a fallu cinq générations pour que le message fasse son chemin.
Dans cette chronique qui s’étend sur un siècle, le romancier se fait l’écho des désirs du peuple, que leurs fils s’élèvent dans la hiérarchie sociale. Mais il s’emploie aussi à dénoncer le manque de vertu du mandarin comparée à la vraie vertu de l’autodidacte. La charge ironique contre les hommes de pouvoir est claire.
Le romancier témoigne aussi du statut des femmes en cette période de polygamie, de leur souffrance, de la culpabilité qu’on leur fait porter si elles ne peuvent mettre au monde un héritier. Si la polygamie a disparu, la nécessité de donner un fils pour continuer la lignée est toujours d’actualité dans le Vietnam moderne.
● « Le sel de la forêt »
Un chasseur est le héros de cette courte nouvelle de quinze pages.
Il part à la chasse au singe, heureux de son nouveau fusil. Il grimpe, il traque les singes, repère un couple et leur petit et choisit de tirer sur le père, sans état d’âme.
Renversement de situation lorsqu’il voit le comportement de la femelle qui risque sa vie pour sauver le mâle, le porter. Alors le chasseur est saisi de remords et fait tout pour sauver l’animal, quitte à se dépouiller complètement.
Par cet apologue, Nguyên Huy Thiêp semble suggérer que l’humanité n’est pas forcément du côté des humains.